Cristallogénèse de complexes E6-inhibiteurs et PDZ-motifs
Responsable de sous-groupe : Alexandra COUSIDO-SIAH
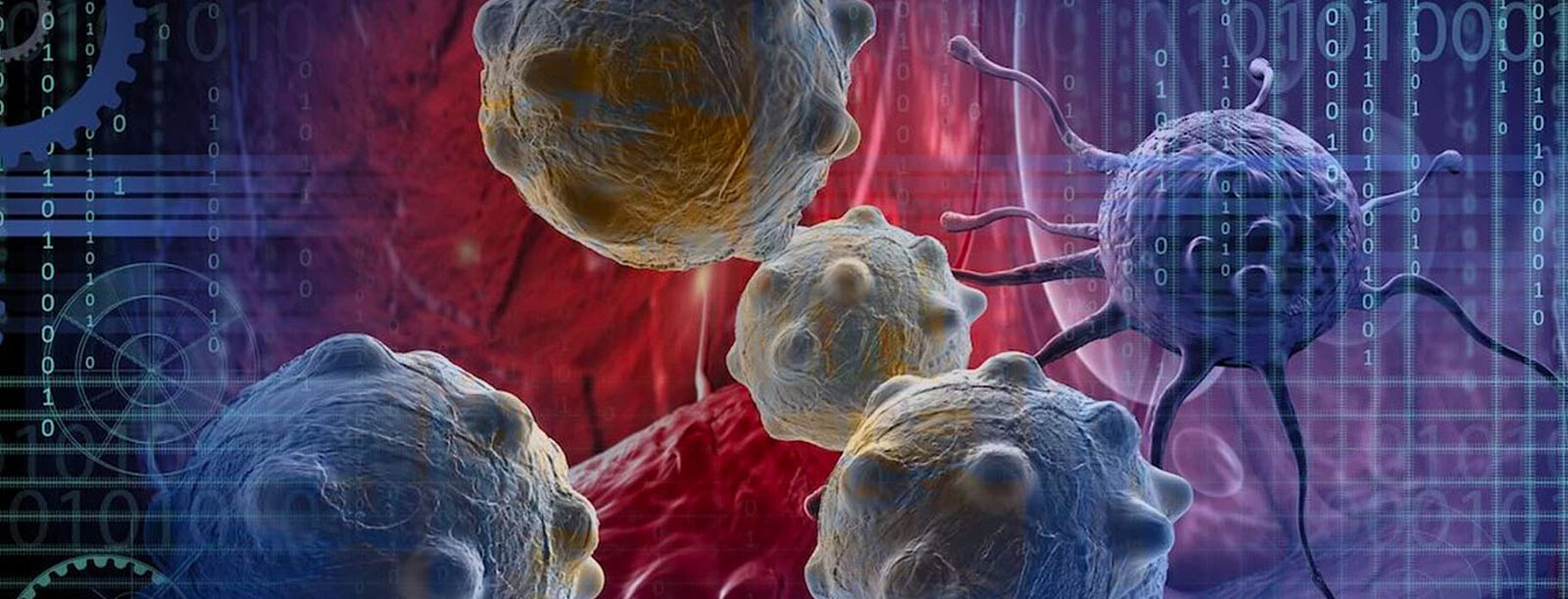
Dans les maladies, les réseaux d'interactions responsables des fonctions cellulaires homéostatiques (normales) sont souvent détournés au profit d'un organisme pathogène, qui peut être un virus ou une bactérie, mais aussi une tumeur. Remarquablement, les virus oncogènes produisent des oncoprotéines (protéines causant le cancer), qui détournent les fonctions cellulaires à deux occasions: d'abord pour le compte du cycle viral, et ensuite pour le compte de la tumeur.
De nombreuses interactions protéines-protéines cellulaires sont médiées par de courts motifs de séquences peptidiques (short Linear Interaction Motifs ou sLIMS) qui lient spécifiquement certaines familles de domaines globulaires. À un réseau domaine-motif donné, correspond souvent une fonction biologique particulière.
Les oncoprotéines virales contiennent souvent des copies de motifs cellulaires ou des poches de liaison à des motifs cellulaires, qui leur permettent d'interférer avec les réseaux cellulaires domaines-motifs responsables de certaines fonctions et éventuellement de les reprogrammer au profit du virus puis de la tumeur.
Notre équipe étudie principalement les oncoprotéines de papillomavirus humains (HPV ou VPH), responsable des cancers du col de l'utérus et également impliqués dans un nombre croissant d'autres cancers épithéliaux (tête et cou, anus, peau...). Les structures à haute résolution d'oncoprotéines du VPH complexées à divers domaines ou motifs issus de protéines humaines-cibles sont résolues et analysées par cristallographie ou RMN, et complémentées par des approches biophysiques (résonance plasmonique de surface, Calorimétrie, dichroism circulaire...). Nous avons aussi développé le "test holdup", une nouvelle approche permettant de mesurer à haut débit des affinités domaines-motifs. Cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour évaluer de façon quantitative la spécificité des interactions protéine-protéine, à l'échelle du protéome.
Ainsi, par ces approches intégrées, nous visons à décrire le détournement des fonctions cellulaires par les virus oncogènes en générant des connaissances précises, quantitatives et exhaustives à deux niveaux d'analyse: atomique et interactomique. De telles informations devraient s'avérer cruciales pour le développement de futures stratégies thérapeutiques contre les cancers induits par les papillomavirus humains.
Responsable de sous-groupe : Alexandra COUSIDO-SIAH
Responsable de sous-groupe : Elodie MONSELLIER
Responsable de sous-groupe : Yves NOMINE
Protein Expression and Purification ; Volume: 51 ; Page: 59-70
Molecular Cell ; Volume: 21 ; Page: 665-78
Journal of Biomolecular NMR ; Volume: 31 ; Page: 129-41
Page 3 sur 3